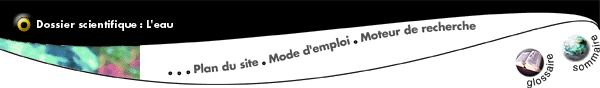|

Marée verte en baie de Lannion en Bretagne. Baies et estuaires
bretons sont envahis chaque été par une algue verte
qui prolifère en raison d’un apport trop important de
nutriments dû aux activités humaines.
|
L’eutrophisation
est une forme singulière mais naturelle de pollution de certains
écosystèmes
aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de
matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci
prolifèrent. Les principaux nutriments
à l’origine de ce phénomène sont le
phosphore
(contenu dans les phosphates) et l’azote
(contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites).
L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes
dont les eaux se renouvellent lentement et en particulier dans les
lacs profonds.
Un lac reçoit en effet, de manière naturelle et continue,
quantités de matières nutritives apportées
par les torrents et les eaux de ruissellement. Stimulées
par cet apport substantiel, certaines algues croissent et se multiplient
de manière excessive. Cette croissance s’effectue dans
les couches d’eaux superficielles car les végétaux
ont besoin de lumière pour se développer. Ces algues
en excès conduisent, lorsqu’elles se décomposent,
à une augmentation de la charge naturelle de l’écosystème
en matières organiques
biodégradables. Dans les profondeurs du lac, là
où les algues mortes viennent se déposer, les bactéries
aérobies
qui s’en nourrissent prolifèrent à leur tour,
consommant de plus en plus d’oxygène.
Or en l’absence d’une circulation suffisante des eaux,
ce qui est souvent le cas dans un lac profond, le fond du lac est
peu oxygéné et les bactéries finissent par
épuiser l’oxygène des couches d’eaux profondes.
Elles ne peuvent plus dégrader toute la matière organique
morte et celle-ci s’accumule dans les sédiments. On
dit que le lac vieillit. Une telle situation, lorsqu’elle se
produit, s’aggrave encore lorsqu’il fait chaud car la
solubilité de l’oxygène dans l’eau (comme
celle de tous les gaz) diminue lorsque la température augmente.
Les régions littorales et les estuaires ne sont pas épargnés
par l’eutrophisation car leurs eaux sont peu brassées
et reçoivent beaucoup de rejets issus de l’activité
humaine. C’est en particulier le cas de nombreux estuaires
bretons.
Dans les cours d’eau rapides, en revanche, dont l’eau
est en permanence renouvelée et mieux oxygénée
et les algues constamment entraînées toujours plus
loin par le courant, aucune accumulation n’est possible.
Ce processus naturel est très lent : il peut s’étaler
sur des siècles ou des millénaires, et parfois sur
de plus longues périodes encore. Mais l’eutrophisation
peut être fortement accélérée par l’apport
d’effluents domestiques, industriels et/ou agricoles et conduire
à la mort de l’écosystème aquatique en
quelques décennies voire même en quelques années.
On parle alors d’hypereutrophisation ou encore de dystrophisation
(voir le chapitre Dégradations).
|